Considérons la lumière qui vient d'une étoile à l'infini. Pour une lumière parfaitement monochromatique, le front d'onde est plan et la phase de l'amplitude complexe ne dépend que de l'altitude z mesurée à partir du sol. A la traversée d'une couche turbulente l'onde voit sa vitesse varier comme l'inverse de n(r,t) si n est l'indice de réfraction pour une position r du plan de la couche et à l'intant t. A son arrivée au sol l'onde possède une phase aléatoire fonction du temps et de la direction d'observation. La réponse impulsionnelle d'un télescope observant une telle onde est toujours le carré du module de l'amplitude complexe découpée par la pupille, mais elle est ici aléatoire. Elle se renouvelle à peu près tous les centièmes de secondes et présente l'aspect granuleux décrit au chapitre précédent. Elle montre en fait une structure à deux niveaux :
 ) et c'est ce qui rend possible la restauration des images dégradées par la turbulence. En moyennant les modules de ces fonctions de transfert instantanées, on améliore le rapport signal sur bruit de l'aile haute fréquence. Celle-ci reste néanmoins affaiblie par rapport à la courbe idéale d'un facteur égal au nombre de speckles, d'autant plus fort que la turbulence est plus grande. Les éventuelles reconstructions d'image seront donc plus difficiles par forte dégradation, ce qui n'est pas très surprenant.
) et c'est ce qui rend possible la restauration des images dégradées par la turbulence. En moyennant les modules de ces fonctions de transfert instantanées, on améliore le rapport signal sur bruit de l'aile haute fréquence. Celle-ci reste néanmoins affaiblie par rapport à la courbe idéale d'un facteur égal au nombre de speckles, d'autant plus fort que la turbulence est plus grande. Les éventuelles reconstructions d'image seront donc plus difficiles par forte dégradation, ce qui n'est pas très surprenant.
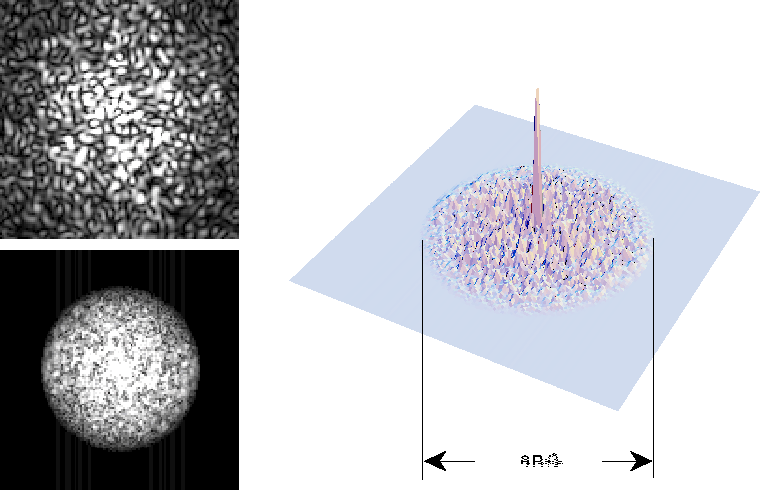
Figure: Image de speckles (réponse impulsionnelle) en haut à gauche. En bas à gauche et à droite, le module de sa transformée de Fourier qui n'est autre que la fonction de transfert instantanée de l'ensemble télescope+atmosphère. Cette fonction est contenue dans une zone circulaire de rayon ![]() et transmet donc de l'information jusqu'à la fréquence de coupure du télescope.
et transmet donc de l'information jusqu'à la fréquence de coupure du télescope.